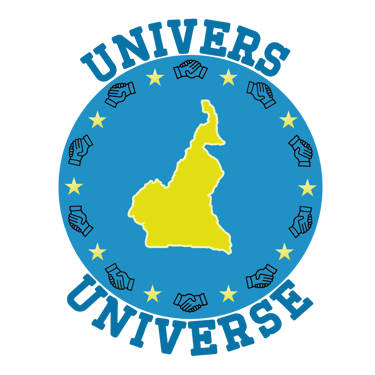Chapitre 8 - De la politique économique
You didn’t come this far to stop
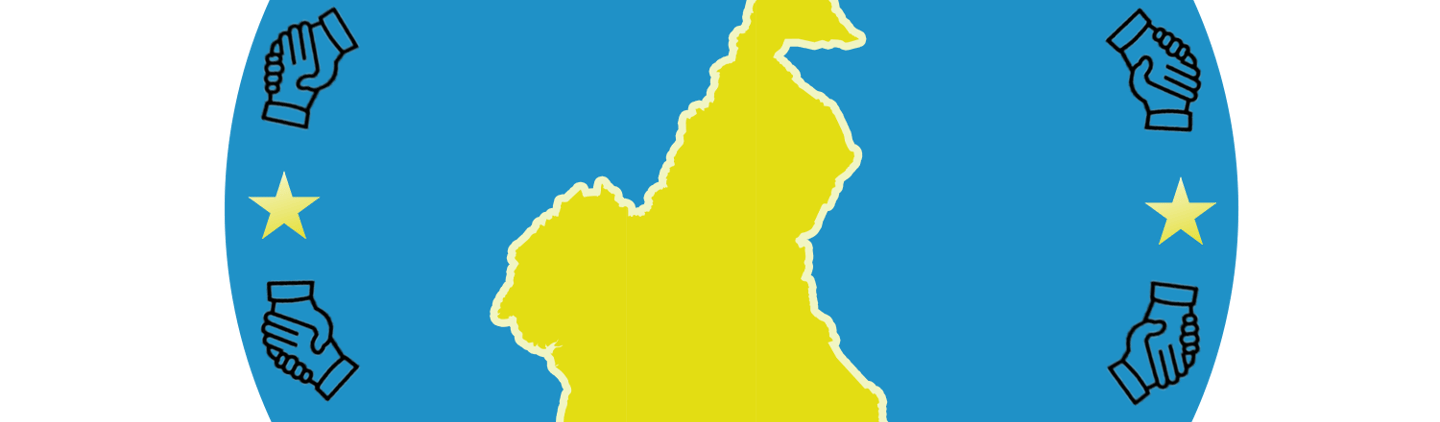

L’économie est l’ensemble des activités d’une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Ce serait une lapalissade que de dire que le secteur de l’économie au Cameroun est sinistré. La reconstruction du Cameroun doit passer par un véritable changement de la politique économique.
Problème
Historiquement, le Cameroun, en tant que territoire, a été mis en place par les Allemands, non pas pour satisfaire aux besoins économiques des camerounais qui y vivaient, mais pour satisfaire aux besoins des colons et aux besoins des européens de la métropole. La politique économique des puissances administratrices qui ont remplacé les Allemands est allée dans le même sens. Les néo-colons qui gouvernent le Cameroun aujourd’hui ne se sont pas départis de cette orientation de la politique économique. On alors, non pas une économie du Cameroun, mais une économie au Cameroun.
L’économie au Cameroun est menée par des dirigeants qui ne pensent qu’à leurs propres intérêts et aux intérêts des puissances étrangères sur lesquelles ils comptent pour se maintenir éternellement au pouvoir. L'intérêt des populations camerounaises importe peu dans le choix des politiques économiques. Dans un tel contexte, l’agriculture encouragée est celle des cultures de rente dont les produits sont exportés à l’état brut, pour alimenter les usines de fabrication des produits finis à l’étranger. Ce qui est dit pour l’agriculture est aussi vrai en ce qui concerne l’exploitation du sous-sol. De cette exploitation, on en tire des produits à exporter à l’état brut. La quasi-totalité des coupes des arbres dans les forêts camerounaises est faite pour envoyer les billes de bois brut à l’étranger. Cette politique d’exportation des matières premières à l’état brut a pour conséquence, leur transformation exclusivement dans les pays étrangers ; ce type d’opération économique se fait au détriment de la main d’œuvre camerounaise. Ce sont des milliers d’emplois que l’on aurait pu offrir aux camerounais qui sont ainsi exportés, pendant que les camerounais sont au chômage.
Pour satisfaire aux besoins des populations camerounais en biens de consommation de première nécessité, on encourage l’importation des pacotilles et des biens déjà utilisés par les populations des pays étrangers, dits « développés ». Le Cameroun se présente alors comme une des poubelles des pays étrangers, dépotoirs des vieux meubles dont on a plus besoin après usage à l’étranger : voitures, vêtements, meubles de maison…Même les aliments que l’on pouvait aisément produire sur place au Cameroun, à travers l’agriculture, la pêche et l’élevage, sont importés : riz, pomme, haricot, orange, viande, poisson… Ceci met fatalement les camerounais en chômage, puisqu’ils ne vivent que du travail des autres. Une telle réalité économique a aussi pour conséquence la dépendance alimentaire des camerounais vis-à-vis des pays étrangers.
Sur le plan humain, tout est mis en œuvre pour empêcher les camerounais d’être des agents de production des richesses ; ils se résignent à n’être que des consommateurs des produits importés, fruit du travail des autres. Ainsi, depuis l’époque coloniale, alors que les colons créent des entreprises de production des richesses, la toute première élite locale, composée des premiers indigènes camerounais lettrés, s’oriente plus vers des activités d’agent de l’Administration publique, très souvent pour des postes de travail subalternes. Après l’indépendance, les camerounais n’ont pas changé d’attitude dans le choix des activités pour leur vie. Ils ont continué à se détourner des activités de production des richesses : l’élite locale est essentiellement composée de fonctionnaires publics. L’école de formation la plus prisée est celle qui produit des administrateurs civils. On est considéré comme manquant d’ambition lorsqu’on s’inscrit dans une école polytechnique ou d’agronomie. Il en est de même de celui qui se lance dans l’agriculture ou dans l’élevage, considérés comme des sous-activités, celles dans lesquelles se lancent ceux qui ont raté leur vie. Le Camerounais voulant créer une entreprise de production de richesse est brimé par les fonctionnaires publics qui contrôlent l’activité économique du pays. Ainsi, le jeune qui veut se lancer dans l’agriculture, ou dans l’élevage, se verra refuser l’accès à la terre par l’Administration publique, gestionnaire des terres du domaine national. Créer une entreprise industrielle ou commerciale relève d’un parcours du combattant ; on est regardé avec dédain par l’agent de bureau auprès de qui le dossier de création doit être déposé ; le dossier plus tard est bloqué dans le bureau du fonctionnaire qui doit l’étudier et délivrer une autorisation d’entreprendre ; une fois installé, on est en permanence harcelé par les mêmes fonctionnaires qui réclament leur « part » dans ce que l’entrepreneur est censé tirer comme bénéfice de son entreprise ; s’il ne se soumet pas, il court le risque de voir ladite entreprise scellée par les fonctionnaires.
Comme à l’époque coloniale, les entreprises de production des richesses continuent à être l‘affaire des grandes firmes étrangères, quelque fois associées aux capitaux de l’État qui mène une politique très peu soucieuse de l’intérêt des Camerounais. Les quelques hommes d’affaires camerounais que l’État laisse prospérer se lancent, généralement, et pour l’essentiel, dans la distribution des biens de consommation importés ; ils sont alors très souvent de simples représentants des firmes étrangères au Cameroun.
Solutions
La Reconstruction du Cameroun, sur le plan de la politique économique, passe par un changement de mentalité. Les camerounais doivent comprendre qu’ils sont les premiers agents de leur propre développement économique. Il est vain de compter sur les étrangers qui n’agissent que dans leurs propres intérêts, même s’ils sont installés au Cameroun et prétendent vouloir aider les camerounais. Pour la Reconstruction du Cameroun, le Parti UNIVERS propose la mise en place d’une politique économique dans laquelle l’État crée des entreprises, à travers le financement public, avec pour objectif final de les rétrocéder exclusivement aux entrepreneurs camerounais. Pour tout dire, une fois que l’entreprise a décollé, l’État se retire, pour s’occuper de ses missions régaliennes. Les camerounais doivent cesser d’être des consommateurs pour devenir des producteurs des richesses. Ceci passe par une économie reposant sur la création des entreprises d’exploitation du sol, du sous-sol et de l’eau, ces ressources naturelles qui ne manquent pas au Cameroun. Par la suite, il faut penser à industrialiser le Cameroun; ceci suppose que l’on trouve des solutions au problème de l’énergie et que soit définitivement tranché le débat sur la monnaie.
Les mesures économiques proposées par le Parti Univers
You didn’t come this far to stop


Mesure 1 – Exploitation des richesses du sol, du sous-sol et de l’eau
Toutes les richesses se trouvent dans la nature ; il suffit simplement de les faire exploiter en faisant travailler les Camerounais.
1°- L’exploitation des richesses du sol
En survolant le Cameroun par avion, on se rend compte de l’immensité des espaces du territoire national non exploités. Toutes ces terres vides peuvent être exploitées. Le sol en lui-même est déjà une richesse de laquelle les camerounais doivent pouvoir tirer profit pour la satisfaction de leur besoins économiques, ceci, à travers des entreprises agricoles, pastorales, forestières et autres.
Les entreprises agricoles
Conscient de l’importance de l’agriculture dans l’économie d’un pays comme le Cameroun, le premier régime politique du Cameroun indépendant avait pensé à lancer ce qu’il avait appelé « Révolution verte ». Il s’agissait d’amener les Camerounais à se lancer dans les entreprises agricoles. L’objectif visé était, pour le Cameroun, d’assurer au moins son autosuffisance alimentaire et ne plus dépendre, pour son alimentation, des produits agricoles importés. Seulement, l’initiative de la création des entreprises agricoles avait été laissée aux particuliers. Cette politique a connu un échec, en dépit de la création d’une banque d’État, le Fond de Développement Rural (FONADER), pour son financement.
La relance du secteur agricole, dans le cadre de la Reconstruction du Cameroun, se fera à partir des entreprises créées par l’État, sur fonds publics. Ces entreprises seront créées et faites pour cultiver les aliments pour consommation des camerounais : les légumes, les tubercules, les graines, les fruits… Les produits sortant de ces entreprises serviront en prioritairement au marché local. L’exportation sera soumise à l’autorisation des pouvoirs publics. Il s’agit alors de faire du Cameroun, un pays totalement indépendant sur le plan alimentaire.
Des programmes d'études devront être lancés dans des universités et centres de recherches pour la conservation des produits agricoles, afin d'éviter leur dégradation après récolte. La politique d'industrialisation (Voir, Mesure 2) devrait permettre la transformation des produits agricoles en d'autres produit de consommation.
Les entreprises d’exploitation des richesses de la forêt
Depuis l’époque coloniale, les forêts du Cameroun sont exploitées par des entreprises étrangères. Celles-ci exportent, à l’état brut, le bois qui en est tiré. Il est temps que les camerounais s’occupent eux-mêmes de leurs forêts et des arbres qui s’y trouvent. Il va donc falloir cesser d’octroyer des permis d’exploitation aux entreprises étrangères, pour les accorder aux nationaux, de façon quasi exclusive. Les autorisations de coupe accordées aux entreprises étrangères seront progressivement réduites, à travers le non-renouvellement des autorisations arrivées à échéances. Il s’agit d’une politique qui vise à amener les camerounais au travail, et à participer à l’activité économique dans leur pays. Le Parti UNIVERS propose que le rythme des coupes des arbres soit ralenti pour éviter une déforestation rapide du Cameroun. Les entreprises opérant dans le secteur seront contraint de se limiter à un nombre précis de coupe, dans des espaces bien délimités. Il sera aussi fait obligation aux entreprises d’exploitation des forêts, de remplacer tout arbre coupé par un autre arbre planté.
Les entreprises pastorales
A l'heure actuelle, les entreprises pastorales au Cameroun sont essentiellement de type artisanal. Le secteur est en butte à de nombreuses difficultés ; on peut citer, entre autres, l’accès limité aux intrants, la dégradation des pâturages, l’insuffisance des points d’eau, constitués essentiellement des cours d’eau naturels. Il va falloir que l’État apporte un soutien considérable aux investisseurs dans le secteur. Les vastes espaces encore vides au Cameroun doivent être mis à contribution pour la relance du secteur qui passera par la modernisation des entreprises pastorales, avec la création des ranchs.
2°- Les entreprise d’exploitation des richesses de l’eau
Par exemples :
- Entreprises de pêche pour avoir du poisson sur le plan local et se passer du poisson importé ;
- Construction des barrages et mini-barrages pour l’approvisionnement en électricité.
Mesure 2 – Industrialisation et transformation des matières premières
Depuis l’époque coloniale, les produits des cultures agricoles sont exportés pour être transformés dans les pays européens. Dans les supermarchés, les camerounais achètent à prix d’or leur café et leur cacao transformés en produits de consommation. Il est impératif que cette exportation de nos produits agricoles, à l’état brut, prenne fin. Il sera proposé aux Camerounais que la transformation de ces produits se fasse sur place au Cameroun et que seuls les produits finis ou semi-semis soient exportés, après satisfaction du marché de consommation local. Bien évidemment, ceci doit se faire progressivement ; l’Etat peut se donner une période de 15 ou 20 ans, pour accompagner financièrement les usines de transformation des matières premières par des camerounais. Ce qui est dit pour les produits agricoles, devra aussi être appliqué avec rigueur en ce qui concerne le bois de nos forêts qui, depuis l’époque coloniale, est exporté à l’état brut.
La même politique doit être menée pour la transformation sur le plan local des produits du sous- sol.
Mesure 3 La politique import-substitution
La politique d''import substitution' consiste à abandonner l'importation des biens pouvant être produits localement. Il s'agit d'un modèle de développement autocentré qui consiste à réduire la part des importations afin de développer le potentiel industriel d'un pays. La substitution aux importations représente une opportunité significative pour le Cameroun d'atteindre l'indépendance économique et une croissance durable. En se concentrant sur le développement des industries locales, le pays peut réduire sa dépendance aux importations, créer des emplois et favoriser l'innovation. Ceci suppose alors que l’on doit revoir certain accord de libres échanges, pour permettre la réduction des importations, tout en favorisant les exportations. Il est inacceptable qu’au Cameroun, on soit encore à importer des biens de consommation de première nécessité qui peuvent bien être produit localement.
Mesure 4- La question de l’énergie
Le Cameroun possède un potentiel énergétique riche et diversifié ; il dispose de vastes ressources énergétiques, notamment l’hydroélectricité, l’énergie fossile et des sources d’énergie renouvelable. Mais, ce pays continue de faire face à des difficultés en la matière et n’arrive pas à répondre aux besoins croissants de sa population, ce qui constitue un obstacle au développement économique. La demande en énergie dépasse largement la capacité de production, entrainant des coupures fréquentes de la fourniture en électricité ; les distributeurs d’énergie se trouvent très souvent dans l’obligation de priver certaines zones ou régions de l’approvisionnement en énergie. Les infrastructures mises en place pour la production de l’énergie sont très souvent vieillies, leur modernisation se heurte très souvent à l’incapacité des gouvernants actuels de mener à terme des projets de rénovation. Au décompte, on peut noter qu’à peine 60% de la population a accès à l’électricité, que l’on retrouve essentiellement en zone urbaine, avec une disparité marquée. Ceci s’explique essentiellement par le fait que la politique énergétique appliquée jusque-là, a été essentiellement orientée vers l’hydroélectricité. Bien qu’il s’agisse-là d’une source importante, elle expose le pays à des risques liées aux changements climatiques, telle que la baisse des précipitations qui affecte la production de l’énergie.
Des problèmes énergétiques que connait le Cameroun, la solution qui coule de source est celle qui consiste à accroitre la production en allant chercher l’énergie où elle se trouve, notamment dans les secteurs non ou insuffisamment explorés et exploités ; il va falloir, par la suite, améliorer la distribution. Il y a nécessité d’optimiser le potentiel hydroélectrique en multipliant le nombre de barrages, en pensant, non seulement à des grands barrages sur les grands fleuves, mais aussi en envisageant des mini-barrages, mêmes sur des rivières à proximité des villages.
Le Cameroun doit diversifier, autant que possible, ses sources d’énergie, en développant d’avantage le solaire, l’éolien et la biomasse. Le pays bénéficie d’un ensoleillement constant qui peut être exploité pour fournir l’électricité. Au-delà du solaire, il va falloir investir dans le gaz naturel. La Cameroun dispose de réserves de gaz naturel qui pourraient être mieux exploitées pour générer de l’électricité. Le développement des centrales électriques à gaz permettrait de réduire la dépendance à l’hydroélectricité et de diversifier les sources d’énergie ; Cela réduirait également les émissions de CO2 par rapport à l’utilisation des centrales thermiques au fioul.
Mesure 5- La question de la monnaie
Le franc CFA, utilisé dans plusieurs pays d'Afrique francophone, est une monnaie héritée de la colonisation française. Le Cameroun, membre de la zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale), est lié à cette monnaie depuis son adoption en 1945. Le débat autour du Franc CFA s'articule autour du point de savoir si cette monnaie doit être maintenue ou alors si elle doit être remplacée par une monnaie nationale indépendante.
Les partisans du Franc CFA mettent en avant plusieurs avantages, à commencer par la stabilité monétaire qu’il procure. Grâce à son ancrage sur l'Euro, le Franc CFA permet aux pays de la zone CEMAC de bénéficier d'une inflation maîtrisée. Un autre argument avancé par les défenseurs du FCFA est que cette monnaie permet d'attirer des investissements étrangers, en raison de la confiance qu'elle inspire aux investisseurs internationaux. Enfin, certains soutiennent que le Franc CFA favorise l'intégration régionale, car il facilite les échanges commerciaux au sein de la zone CEMAC. Une monnaie commune permet de réduire les coûts de transaction et de faciliter le commerce intrarégional.
L’un des principaux arguments contre le Franc CFA est la perte de souveraineté monétaire pour le Cameroun. En étant arrimé à l’Euro, le pays n’a pas la capacité de manipuler sa monnaie pour stimuler son économie, par exemple en dévaluant le Franc CFA pour rendre ses exportations plus compétitives. Par ailleurs, le taux de change fixe entre le Franc CFA et l’Euro contribue à une surévaluation de la monnaie camerounaise par rapport à sa productivité réelle. Cette surévaluation réduit la compétitivité des produits locaux sur les marchés internationaux, car les biens exportés deviennent plus chers pour les acheteurs étrangers. À long terme, et selon les adversaires du Franc CFA, ce système freine la diversification économique du Cameroun. En maintenant une monnaie forte, le Franc CFA encourage l'importation des produits manufacturés au détriment du développement industriel local. Un autre facteur limitant du Franc CFA est la dépendance vis-à-vis des réserves françaises. Les pays de la zone Franc CFA, dont le Cameroun, sont tenus de déposer une partie de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Cette pratique limite la capacité des États membres à utiliser pleinement leurs réserves pour financer des projets de développement nationaux ou pour faire face à des urgences économiques.
Le Parti UNIVERS, une fois au pouvoir, posera le problème du Franc CFA sur la table de discussion. Le peuple camerounais sera appelé à se prononcer sur la question, après éclairage des experts camerounais venant de tous les bords socio-politiques. On décidera alors s’il faut créer une monnaie nationale indépendante ou alors s’il faut maintenir le Franc CFA, tout en accordant une plus grande autonomie aux pays membres, tout en maintenant certains avantages de la stabilité monétaire. Les réformes pourraient inclure une plus grande participation des pays africains dans la gestion de la monnaie, ainsi qu'une révision des accords de coopération monétaire avec la France. L'une des réformes possibles serait de réduire ou d'éliminer l'obligation de dépôt des réserves de change auprès du Trésor français, la réduction de l’obligation de déposer 50 % des réserves de change auprès du Trésor français.