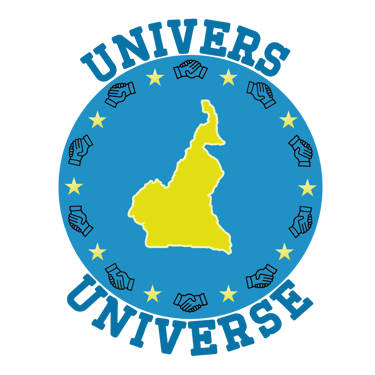Chapitre 11 - La justice au service du citoyen et du développement
You didn’t come this far to stop


Dans une société civilisée, nul n’a le droit de se faire justice à soi-même ; il est alors nécessaire que la mission de rendre justice soit confiée à des institutions publiques, rattachées au Pouvoir judiciaire. Pour mieux rendre la justice, ces institutions doivent être indépendantes du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif. Il revient à l’État la lourde tâche d’organiser les institutions chargées de rendre la justice. La justice au Cameroun, aussi bien dans son organisation que dans son fonctionnement, connaît des problèmes auxquels des solutions doivent être envisagées
Problème de la justice au Cameroun
La justice de l’État camerounais est en crise. Une crise reflétée par le « divorce » désormais consommé entre cette justice et les justiciables. L’État a voulu organiser une justice moderne, répondant, par ses structures et des règles de fonctionnement, aux exigences du modèle prétendu universel d’État-nation, dans sa version libérale. Mais cette justice, qui s’appuie sur des techniques et méthodes importées d’Occident, va se heurter à l’incompréhension des justiciables insuffisamment préparés pour faire face à un système de règlement des litiges prévu pour une société autre que la leur. On assiste alors au rejet de la justice de l’État. Les solutions mises en place par l’État pour rétablir le dialogue entre sa justice et les justiciables vont se révéler vaines.
La crise de la justice de l’État est loin d’être un phénomène isolé. Elle doit être appréhendée dans le cadre plus large de la crise du droit de l’État, essentiellement marqué par une influence occidentale. En effet, le droit de l'Etat au Cameroun est construit sur des principes philosophiques en vigueur en Europe à une époque aujourd’hui révolue. Le droit de l’État camerounais n’est que la transposition des solutions juridiques élaborées ailleurs, que l’élite intellectuelle, formée à l’école occidentale, a voulu imposer à tous comme arbitre suprême en lui conférant le monopole de la régulation sociale. Sur le plan formel, ce droit existe. On peut le lire sur le papier où il est inscrit. Mais ce droit est ignoré dans les quartiers et villages camerounais. Une bonne partie de la société vit en marge du droit de l'Etat.
Les juridictions où l’on applique le droit de l’État sont désertées par les justiciables camerounais. Pour ces derniers, la justice de l’État manque de crédibilité. Pour une majorité de camerounais, c’est une justice faite pour les « blancs », les « intellectuels » et les riches. On comprend alors pourquoi très peu de camerounais se réfère aux juridictions étatiques pour le règlement des litiges qui les opposent, notamment dans les affaires non-répressives. S’agissant de la justice répressive, les citoyens sont dans l’obligation de s’y présenter et de s’y soumettre. Ceci s’explique par le fait que pour la justice répressive, le demandeur est toujours le Ministère public, institution publique, avec ses pouvoirs exorbitants, notamment celui de contraindre ses adversaires à se présenter devant le juge étatique.
Au-delà de tout ce qui vient d’être dit, il faut reconnaitre que la justice camerounaise, telle qu’elle s’impose aux justiciables, connait une crise liée à un certain nombre de maux dont elle souffre. Les juridictions sont en nombre très insuffisant ; les juges sont loin d’être indépendants dans leur office ; ils subissent tous les jours des pressions de toutes sortes lorsqu’il s’agit de rendre justice ; la toute-puissance du Ministère public, avec en face des avocat affaiblis par un statut qui ne leur accorde pas une autorité suffisante pour contrer les pouvoirs exorbitants accordés aux Procureurs. Le mauvais usage des privations des libertés fait penser que la justice est faite pour brimer les citoyens. Le Parti UNIVERS entend proposer des solutions pour réduire, autant que possible, l’ampleur de ces maux qui minent la justice camerounaise de l’heure, afin que l’institution de la justice soit véritablement mise au service des citoyens et du développement.
Mesures à prendre pour la justice
You didn’t come this far to stop


Mesure 1- Au moins une juridiction dans chaque Arrondissement
Les lois relatives à l’organisation judiciaire prévoient au moins un Tribunal de première instance dans chaque Arrondissement du Cameroun. Malheureusement, ce texte reste théorique. A l’heure actuelle, il faut se rendre à un Chef-lieu de Département pour rencontrer une juridiction devant laquelle on peut demander justice. La justice camerounaise est, de ce fait, très éloignée, géographiquement des justiciables. Le Parti UNIVERS estime qu’il est important de mettre en exécution ces textes qui prévoient au moins une juridiction dans chaque Arrondissement du Cameroun. La justice se rapprocherait ainsi géographiquement des justiciables. La multiplication du nombre de juridictions devra alors s’accompagner d’un recrutement massif des fonctionnaires appelés à y officier.
Face à l’éloignement géographique des juridictions et à leur difficile accès, les camerounais ont développé le reflexe, chaque fois qu’ils entendent revendiquer leurs droits, de se rendre dans les postes de police ou de gendarmerie, que l’on retrouve quasiment à tous les coins du territoire national. La gouvernance étatique devrait apprivoiser cette tendance et s’y adapter. On pourrait alors créer des bureaux de justice, dans ces postes de police et de gendarmerie. On y affectera des jeunes magistrats, ou même de simples diplômés en droit, qui seront chargés de régler des petits litiges entre les citoyens. L’officier de police qui reçoit une plainte pour une affaire civile, ou pour des infractions mineures, pourra simplement la transmettre au bureau de la justice, logé dans le bâtiment abritant le poste de police ou de gendarmerie.
Mesure 2- Démocratiser l’accès à la fonction de juge
Au Cameroun, les juges sont nommés par décret du Président de la République, en sa qualité de Président du Conseil supérieur de la magistrature. Quoi qu’on dise, le juge est loin d’être indépendant. L’évolution de sa carrière dépend des bonnes ou mauvaises relations qu’il entretient avec les hommes du Pouvoir exécutif. Si l’on veut que la justice soit réellement rendue au nom du peuple, il faut démocratiser l’accès à la fonction du juge. Le Parti UNIVERS propose cette démocratisation à deux (2) niveaux : Au niveau de l’accès à la fonction de juge et au niveau de la désignation comme juge dans une affaire précise.
Le Parti UNIVERS propose que l’accès à la fonction de juge se fasse par voie d’élection démocratique. Le juge sera élu pour une période déterminée et renouvelable. Le corps électoral sera composé des hommes de loi en service dans le ressort de la juridiction ; il sera notamment constitué des juges en fonction, des magistrats de parquet, des avocats, des huissiers, des notaires, des greffiers et des officiers de police judiciaire. Les candidats aux fonctions de juge devront justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) dans un des corps admis dans le collège électoral. Les Enseignants de droit des Universités, les fonctionnaires de catégorie A et les cadres du secteur privé, ayant une formation de juriste et ayant exercé une activité professionnelle liée au droit, pourront également être admis à se présenter aux élections des juges. On mettra ainsi en place une véritable corporation des juges, avec au-dessus, un "Conseil supérieur de la justice", présidé par un juge élu par les membres de ce Conseil. Les juges, membres du "Conseil supérieur de la justice", seront eux-mêmes élus par les juges en exercice. Ce système d’élection amènera les juges à faire plus attention dans le rendu de leurs décisions, conscients que ce qu’ils ont des comptes électoraux à rendre à des savants du droit qui observent leurs activités juridictionnelles, et qui peuvent les sanctionner en ne renouvelant pas leurs mandats de juge.
Le deuxième niveau de démocratisation de la fonction de juge consistera, pour les justiciables, à désigner eux-mêmes le ou les juges appelés à statuer dans leurs affaires. Dans le ressort d’une juridiction, les juges figurent sur une liste officielle, affichée au Palais de justice. C’est sur cette liste que les justiciables viennent choisir leurs juges pour le règlement de leur litige. Ainsi, deux parties aux litiges peuvent choisir la formule du juge unique. Elles se mettent alors d’accord sur le juge à désigner. A défaut d’accord, on procède à un tirage au sort. Lorsque les parties optent pour un collège de juges, chacune désigne un juge ; les deux juges désignés par les parties se chargent à leur tour de désigner un de leur collègue qui préside la collégialité ; A défaut d’accord, on peut tirer au sort un juge qui officiera comme président. Ce système de désignation amènera les juges à faire plus attention dans le rendu de leurs décisions, conscients que ce qu’ils ont des comptes à rendre aux justiciables dont la satisfaction ou non aura des conséquences sur l’évolution de sa carrière de juge. Le système de désignation des juges par les justiciables va prévoir un mode d’évaluation avec des points attribués en fonction du sort réservé à la décision rendue par le juge. On pourra ainsi attribuer un nombre élevé de point à un juge qui rend une décision qui ne fait pas l’objet de recours. L'absence de recours montre en effet que la décision rendue par le juge est acceptée par toutes les parties au procès: on présume alors que la décision est bonne et le juge est bon. Si la décision du juge est contestée et fait l’objet d’un recours, le juge obtient un peu moins de point. Il en obtiendra encore moins si sa décision est annulée ou cassée par une juridiction supérieure. Évidemment, un juge qui n’est pas choisi n’a aucun point. Le juge qui entend renouveler son mandat de juge doit afficher à son compteur un certain nombre de points. Pour être candidat à l’élection pour accéder à une juridiction supérieure, le juge doit avoir obtenu, au cours de son mandat dans une juridiction inférieure, un certain nombre de points qu'une norme juridique fixera.
Mesure 4 - Réduire les pouvoirs exorbitants du Ministère public
Le Problème
Le Ministère public est l'autorité judiciaire chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et de ce fait, chargée de demander que le droit soit respecté et appliqué dans les juridictions. Les Procureurs incarnent le Ministère public. On l’a toujours dit, le Ministère public n’est que partie au procès. Mais, le système judiciaire lui octroi des pouvoirs exorbitants qu’il peut exercer contre les justiciables qui sont ses adversaires, notamment en matière pénale. Ainsi, le Procureur est en droit de décerner un mandat de détention provisoire contre son adversaire, la personne poursuivie. Pendant que cette dernière est privée de liberté, elle ne peut pas se mouvoir librement, à la recherche de ses moyens de défense. On dirait un boxeur qui incarcère son adversaire, l’empêchant ainsi de s’entrainer pour le combat programmé. La balance que représente la justice est ainsi penchée d’un côté et ce, en faveur du Ministère public. Par ailleurs, il existe de nombreux éléments de droit processuel qui font du Ministère public, le véritable « Janus » de la justice au Cameroun : il peut ainsi paralyser une instruction en bloquant dans ses tiroirs le dossier de la procédure, en retardant la délivrance de ses réquisitions ; il peut par son absence bloquer le début ou la continuation d’une audience du juge pénal ; il intervient dans l’exécution des décisions de justice, ce qui lui donne le pouvoir de bloquer l’exécution d’une décision rendue en sa défaveur.
Solutions
Pour une justice équitable, garantissant l'égalité des chances à toutes les parties au procès, le juge doit redevenir celui qui seul, incarne la justice. Le juge doit être le maitre de toute procédure judiciaire, de son déclenchement jusqu’à son aboutissement par l’exécution des décisions qu’il rend. On doit donc pouvoir admettre qu’un procès pénal puisse se dérouler en l’absence du Procureur, représentant du Ministère public, qui refuse de venir à l’audience à laquelle il a été convié ; on doit lever tous ces verrous procéduraux, contenus dans les codes, qui permettent au Procureur de bloquer des procédures judiciaires selon son bon vouloir, tout en plaçant le juge sous sa dépendance procédurale. Tout placement en détention provisoire doit être ordonnée par un juge et non par le Procureur ; l’exécution des décisions de justice doivent être l’affaire exclusive d’un juge de l’exécution, même dans les affaires pénales. À ce sujet, le juge doit avoir une autorité directe sur la force publique, notamment, en matière d’exécution des décisions de justice, ce qui n’est pas le cas dans le système actuel.
Mesure 4. La protection de la profession d’Avocat défenseur
Problème
L’Avocat-défenseur est un acteur clé de la justice. Ses interventions auprès des justiciables permettent, dans une certaine mesure, un contrepoids, notamment en matière pénale, face à la toute-puissance du Ministère public. Seulement, le statut de l’Avocat, tel qu’il existe aujourd’hui, présente de nombreuses faiblesses qui conduisent à une diminution de son influence et de son autorité. En effet, alors que les autres acteurs majeurs de la justice, à savoir les magistrats et les officiers de police judiciaire, bénéficient du "privilège de juridiction", l’avocat n’en bénéficie pas du tout. On verra ainsi un Avocat être poursuivi en matière pénale, devant les juridictions dans le ressort duquel il a son cabinet. Le Procureur peut ainsi profiter d’une procédure pénale, qu’il a le droit d’initier contre l’Avocat, pour lui régler des comptes. L’Avocat peut ainsi être placé en garde-à-vue, à tort ou à raison, et même être détenu provisoirement, sur ordre du Procureur, son contradicteur de tous les jours. On se demande alors qu’elle autorité un Avocat aura devant un Procureur qui, à tout moment, peut décider de l’humilier ainsi ? Quel crédit et quelle confiance les justiciables vont-ils encore accorder à un Avocat qui, lui-même, est traité comme le sont ses propres clients, par des officiers de police judiciaire et les magistrats du ressort judiciaire ou il est installé. Dans l’intérêt de la justice, les Avocats méritent d’être protégés, dans leur dignité, dans leur crédibilité et dans leur autorité.
Solution
La solution consiste simplement à faire bénéficier à l’Avocat, aux moins le "privilège de juridiction", tel qu’il est accordé aux magistrats et aux officiers de police. Aucun Avocat ne devrait être poursuivi et jugé devant une juridiction pénale de droit commun. Nul n’étant au-dessus de la loi, toutes les affaires pénales concernant les Avocats devraient être jugées à huis clos. Par ailleurs, le jugement d’une affaire pénale concernant un avocat devrait toujours l’être par une juridiction spéciale et en collégialité ; il appartiendra au Président du Conseil supérieur de la justice de désigner les juges appelés à connaitre d’une telle affaire. Parmi les juges appelés à composer la collégialité, on doit avoir u moins un représentant du Barreau des Avocats.
Mesure 3- Mettre fin à l’enfermement des personnes ne représentant aucun danger pour la société
Problème
La privation de liberté ordonnée contre des personnes poursuivies en matière pénale est souvent utilisée comme un instrument d’humiliation ; la mesure est même utilisée, par les autorités policières et judiciaires comme moyen de chantage, à des fins de corruption. Le code de procédure pénale a, en théorie, permis des avancées, en interdisant la garde à vue ou la détention provisoire, en cours de procédure, à l'encontre des personnes ayant une résidence connue. Mais, en pratique, on continue de priver de liberté des personnes ayant une résidence bien connues, poursuivies, même pour des infractions mineures, et ne présentant aucune menace pour la société.
Solution
Pour le Parti UNIVERS, seules les personnes dangereuses devraient être neutralisées par une privation de liberté : bandits de grand chemin, personnes sans domicile, personne affichant une attitude violente et présentant une menace pour plusieurs personnes... Pour la préservation des preuves, souvent présentée comme prétexte pour priver une personne de sa liberté pendant que la procédure est en cours, on peut envisager d’autres mesures plus respectueuses de la dignité de la personne poursuivie : interdiction d’accéder à certains lieux, d’entrer en contact avec certaines personnes, mesure de surveillance… On l’éloignera autant que possible de ce qui l’a amené à commettre l’infraction ; Seul le non-respect de ces prescriptions des autorités judiciaires pourra conduire à une détention préventive. Les dossiers des personnes détenues préventivement devront être traités prioritairement et dans les meilleurs délais. Au cas contraire, elles doivent être remises en liberté, pour comparaître libre.
Au delà de la procédure pénale, le code pénal, qui prévoit des sanctions pénales, devra être toiletté, pour supprimer l’emprisonnement pour les infractions commises par des personnes dont la liberté ne constitue pas un danger pour la société. Dans tous les cas, les peines d’amende, et les condamnations à effectuer des travaux d’intérêt général, devront toujours être préférées à l’emprisonnement. L’emprisonnement sera réservé aux récidivistes, aux délinquants violents, aux bandits de grands chemins, aux personnes dangereuses pour la société. Un accent particulier doit être mis sur les mesures de sureté dans les décisions des juges.
Les amendes pour être dissuasives, seront fixées en fonction des revenus de la personne condamnées. Elles pourront être remplacées dans tous les cas, par des travaux d’intérêt général équivalant au montant de l’amende. La personne emprisonnée pourra également effectuer des travaux d’intérêt général pour permettre la réduction de sa peine.
Mesure 4- Repenser la prison
La prison doit cesser d’être un lieu de souffrance pour la personne condamnée ; elle doit être un cadre de traitement curatif de la personne qui a adopté un comportement déviant. Pour le Parti UNIVERS, le délinquant est un malade qu’il faut soigner. La prison doit avoir pour mission de transformer le mauvais citoyen en bon citoyen. Durant son séjour en prison, le délinquant ou le criminel devra recevoir des cours d’instruction civique et de droit, subir un traitement psychologique et mental ; celui qui n’a pas de métier à son entrée en prison, doit en apprendre un, pendant qu’il y est. Les pouvoirs publics doivent aider à la réinstallation et à l’intégration sociale et professionnelle de l’ancien prisonnier. Lorsque l’emprisonnement tend vers son terme, le prisonnier doit bénéficier, assez régulièrement, des corvées libres hors de la prison, pour préparer sa nouvelle vie d’homme libre.
Pour le Parti UNIVERS, aucune prison ne doit avoir un nombre de prisonniers supérieur à sa capacité d’accueil et d’encadrement. Toutes les prisons, sur toute l’étendue du territoire, doivent être en mesure de recevoir les condamnées venant de toutes les juridictions du Cameroun. S’il arrive que toutes les prisons soient pleines, on devra libérer les condamnés déjà proches de la sortie, ayant déjà purgé une bonne partie de leur peine, ou en vertu d’autres critères que la norme juridique fixera, pour faire de la place aux nouveaux prisonniers.
Mesure 5 - Lutte contre les lenteurs judiciaires
L’un des maux dont souffre la justice camerounaise en ce moment est celui des lenteurs judiciaires. Des demandeurs à la justice engagent des procédures judiciaires, mais la décision est rendue très tardivement, laissant pendant tout ce temps, triompher le non-droit. On a souvent expliqué ces lenteurs judiciaires par un certain nombre de réalités : insuffisance des juridictions, déficit du personnel judiciaire, problèmes budgétaires dans le fonctionnement de la justice et autres. Mais, le Parti UNIVERS pense qu’au delà des solutions à trouver pour traiter ces maux, déjà diagnostiqués, il faut aussi s’attaquer au problème de la "mise en état" des affaires. En effet, dans la pratique, la plupart des affaires arrivent devant le juge de jugement alors qu’elles ne sont pas en état d’être jugées ; elles sont alors, dans un premier temps, renvoyées pour des raisons diverses : consignation, production de telle ou telle pièce de procédure, échanges des écrits entres les parties, conclusions, répliques, dupliques, à n’en point finir. La pratique dans les juridictions est de renvoyer des affaires pour au moins une période d’un mois. On a alors des dossiers qui, après plus d’un an, ne sont toujours pas en état d’être jugés.
Comme solution à ce phénomène, le Parti UNIVERS propose de généraliser la procédure préalable de "mise en état" des affaires, avec l’instauration systématique d’un juge de la "mise en état" pour toutes les affaires, répressives ou non-répressives. Le juge de la "mise en état" appelle les parties dans son bureau, pour la procédure de "mise en état". S’il s’agit de permettre à une partie au procès de produire une pièce ou des écrits, le juge de la "mise en état" fixera un délai de cette production qui ne devrait pas être long : quelques heures, un jour, deux jours, trois jours… Ce délai pourrait aussi être négocié entre les parties et le juge de la "mise en état". Après l’instruction, le dossier est transmis au juge de jugement qui fixe la date pour les débats et les plaidoiries.